Après plus de trois ans de guerre et
plusieurs trains de sanctions, Moscou continue de susciter autant de passions
que de mystères.
Dans la propagande occidentale, la Fédération de Russie apparaît comme un pays
ruiné par la guerre, mis au ban des nations, et réduit à un quasi-protectorat
de l’Empire du Milieu. À l’opposé, selon les médias alternatifs, la Russie est
présentée comme un pays d’opportunités, qui a su se réorienter stratégiquement
vers l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique regroupés sous l’appellation de "Sud
global" dans la terminologie occidentale.
Dans les lignes qui suivent, nous allons décortiquer ces deux paradigmes
opposés pour tenter d’y voir plus clair. Le 22 février 2022 marque le début de
ce que Moscou qualifie "d’opération militaire spéciale", tandis que
les pays occidentaux y voient une guerre d’agression contre l’Ukraine. Cette
guerre, loin d’être un événement spontané, puise ses racines profondes dans des
événements antérieurs, notamment la Révolution orange de 2004 et le
renversement du pouvoir pro-russe lors du soulèvement de Maïdan en 2014, que
certains qualifient de coup d’État soutenu par l’Occident.
Aux yeux du Kremlin, cette intervention militaire avait pour but de protéger
les populations russophones et russophiles vivant à l’est de l’Ukraine, des
communautés issues de l’éclatement de l’Union soviétique en 1991 et qui se
retrouvent depuis dispersées dans plusieurs ex-républiques soviétiques. Par
ailleurs, Moscou invoque un engagement verbal remontant à la fin de la Guerre
froide : lors des négociations pour la réunification de l’Allemagne, Mikhaïl
Gorbatchev aurait reçu l’assurance que l’OTAN ne s’étendrait pas vers l’Est,
notamment dans les anciens pays du Pacte de Varsovie. Selon cette lecture
historique, l’élargissement progressif de l’OTAN constitue une violation de cet
accord tacite et une menace directe pour la sécurité nationale de la Russie.
C’est dans ce contexte que Vladimir Poutine estime avoir l’obligation de
corriger ce qu’il considère comme une injustice historique majeure, en tentant
de restaurer une forme de sphère d’influence russe sur son « étranger proche ».
Face à cette guerre, les pays occidentaux au premier rang desquels les
États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l’Union européenne ont adopté une série de sanctions économiques
sans précédent à l’encontre de Moscou, dans le but affiché de faire plier la
position du Kremlin. On se souvient notamment de la déclaration du ministre
français de l’Économie, Bruno Le Maire, affirmant : « Nous allons mener une
guerre économique totale à la Russie. » Cette annonce résumait l’intensité de
la riposte occidentale.
Parmi les mesures emblématiques figurent :
L’exclusion de Moscou du système de paiement interbancaire SWIFT, réduisant
fortement sa capacité à effectuer des transactions financières internationales.
Le blocage du projet gazier Nord Stream II, censé renforcer l’approvisionnement
énergétique de l’Europe en provenance directe de la Russie.
Le départ massif de grandes entreprises occidentales telles que L’Oréal,
McDonald’s, KFC, IKEA et bien d’autres, marquant un désengagement économique et
symbolique.
La confiscation des avoirs de l’État russe détenus dans les banques européennes
et américaines.
Le gel des avoirs de plusieurs oligarques russes, proches du pouvoir, censés
exercer une influence sur le président Poutine.
Ces sanctions visent à isoler la Russie économiquement, à tarir les ressources
financières de l’État russe, et à provoquer un changement de cap stratégique à
travers une pression politique et sociale interne. Malgré l’ampleur des
sanctions occidentales, la Fédération de Russie a su réorienter son économie
vers de nouveaux partenaires stratégiques.
Parmi ces partenaires figurent la République populaire de Chine, l’Inde, la
Turquie, les Émirats arabes unis, ainsi que plusieurs pays d’Afrique et d’Asie
centrale, notamment le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan. Ces États
servent non seulement de relais commerciaux, mais aussi de plateformes pour
contourner une partie des sanctions économiques imposées par les États-Unis et
l’Union européenne.
Grâce à cette réorientation, l’économie russe a montré une résilience notable.
Au premier trimestre de l’année en cours, la Russie a affiché un taux de
croissance supérieur à celui de la zone euro, avec une progression d’environ 1
%. Par ailleurs, la Fédération de Russie demeure un acteur central dans
plusieurs secteurs clés à l’échelle mondiale :
Premier exportateur mondial de blé, contribuant largement à la sécurité
alimentaire de nombreux pays du Sud.
Fournisseur majeur d’engrais chimiques, essentiels pour l’agriculture mondiale.
Exportateur stratégique de gaz naturel, notamment via ses relations renforcées
avec la Chine et d'autres pays non alignés sur les sanctions.
L’industrie manufacturière russe représente environ 33 % du PIB, un chiffre
élevé qui témoigne de la solidité de son tissu productif. Par ailleurs, selon
la mesure en parité de pouvoir d’achat (PPA), la Russie se classe actuellement
comme la quatrième économie mondiale, derrière la Chine, les États-Unis et
l’Inde.
Le pays poursuit également ses ambitions industrielles, avec le développement
d’avions comme le Sukhoï Superjet 100, symbole d’une volonté de souveraineté
technologique face à l’isolement occidental. Sur le plan intérieur, la vie
quotidienne du citoyen russe moyen ne semble pas avoir été profondément
bouleversée. Des programmes sociaux innovants ont été mis en œuvre pour
soutenir le pouvoir d’achat, moderniser les infrastructures, et maintenir une
certaine stabilité économique. Moscou, en tant que capitale, incarne
aujourd’hui à la fois la puissance politique et la résilience économique de la
Fédération de Russie. Un pays dont les dirigeants prennent des décisions
pragmatiques, affranchies des dogmes idéologiques, est capable de surmonter les
défis économiques , même face à la pression d’un Occident devenu numériquement
minoritaire sur la scène mondiale.
Auteur : Joseph Wilfrid
Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :

.png)
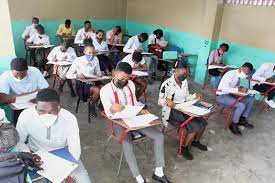

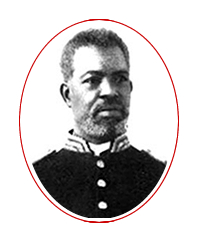


.png)

Commentaires
Publier un commentaire