Ambition et instabilité : peut-on encore rêver grand ?
Ambition et instabilité : peut-on encore rêver grand ?
Le même refrain revient sans cesse dès qu’il est question de développement. En Haïti, on ne
peut pas rêver grand. À force de l’entendre, on finit par l’intérioriser. Dans un pays où la survie
se joue au jour le jour, comme un contrat de 24 heures qu’on espère renouveler, l’ambition
devient presqu’un luxe.
Pris en étau entre des inégalités sociales criantes et des dirigeants qui, par leur indifférence ou
leurs décisions, semblent nous rappeler que notre existence dérange, il est légitime de se poser la
question : ai-je encore le droit de rêver grand ? À quoi bon faire des projets si le sol sur lequel ils
doivent s’ancrer se dérobe chaque jour un peu plus sous nos pieds ?
Et pourtant, malgré ce sentiment d’abandon, il y a en chacun une étincelle qui refuse de
s’éteindre. Une envie de croire que nos rêves, même fragiles, ont leur place.
En dépit de ce désordre social qui nous accable, la jeunesse haïtienne se retrouve face à deux
défis majeurs. D’un côté, nous évoluons dans un pays accusant plus d’un siècle de retard. De
l’autre, nous aspirons, souvent par nécessité, parfois par pression, à ressembler à des sociétés qui
ont, elles, presque deux siècles d’avance sur nous.
Ce décalage, à la fois historique et structurel, a tendance à créer une tension permanente entre ce
que nous sommes et ce que nous rêvons d’être. Et c’est dans cet espace flou que naît une
acculturation parfois excessive, où l’on oublie peu à peu nos repères, nos valeurs, et même notre
langage intérieur.
L'acculturation, définie comme le processus par lequel une culture dominante impose ses
valeurs, ses normes et ses modes de pensée à une autre, plus vulnérable, est une forme subtile
mais puissante de domination. Elle agit lentement, souvent silencieusement, jusqu’à effacer
l’essentiel de ce que nous sommes, nos références culturelles, notre pensée politique, notre
rapport à l’histoire et même à la langue.
Nous finissons par adopter, sans même nous en rendre compte, ce que nous critiquions hier.
Sinon, comment expliquer qu’en Haïti, dans un pays où le journalisme devrait être un rempart
contre la dérive intellectuelle, certains professionnels des médias, supposément guidés par
l’éthique, offrent leur plateforme à des adolescents de seize à vingt ans pour débattre à la légère
de sujets complexes, parfois existentiels, qui dépassent non seulement leur âge mais aussi leur
bagage intellectuel ?
Pire encore, nous assistons à la normalisation de comportements déviants chez les jeunes, qui, en
quête de reconnaissance, s'adonnent à des actes de dépravation. Ces comportements, d'abord
tolérés, sont ensuite utilisés pour discréditer ceux qui les ont adoptés, transformant ainsi la quête
de gloire en un piège.
Dans un tel contexte, il devient difficile de trouver des repères. La situation du pays est souvent
invoquée comme cause principale, mais soyons honnêtes, cette crise apparente masque une
réalité plus profonde. Nous chérissons en secret des valeurs et des comportements qui,
collectivement, nous éloignent de notre essence.
L’instabilité ne commence pas seulement dans les rues agitées ou dans les institutions fragiles.
Elle s’installe d’abord en nous, dans nos gestes quotidiens, dans nos contradictions silencieuses.
Elle se loge dans nos mœurs que nous délaissons, dans ces petits renoncements que l’on banalise.
À force de rejeter ce qui nous définit, de délaisser ce qui nous lie à notre histoire, nous
déracinons peu à peu notre propre équilibre. Ce sont ces écarts, en apparence anodins, qui nous
éloignent de notre identité, de nos valeurs, et nourrissent l’instabilité plus grande de notre
société.
Peut-on encore rêver grand ? Oui, mais à une condition essentielle : se connaître soi-même,
savoir pourquoi on se bat, et comment mettre ses compétences au service d’un pays secoué mais
encore debout.
Des jeunes brillants partent, apprennent, reviennent avec des idées inspirantes, mais souvent
déconnectées de nos réalités. Cet écart illustre notre tendance à vouloir copier plutôt que
construire. On veut faire *comme eux*, adopter leurs méthodes, leur mode de vie, oubliant que
ces « autres » sont aussi en partie responsables de nos cicatrices historiques.
L’ambition reste légitime. Mais elle doit naître d’un engagement sincère, pas seulement d’une
projection financière. Il faut certes apprendre d’ailleurs, mais surtout pour se bâtir ici. Pas pour
renier nos racines, ni pour singer les modèles qui nous éloignent de nous-mêmes. Rêver grand,
c’est aussi rêver vrai, en phase avec nos valeurs et nos urgences.
Auteur : Christnoude BEAUPLAN
Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :
- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html
- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9
- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9
- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation
- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique
- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points
Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

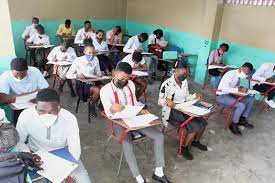
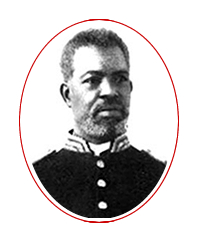


Commentaires
Publier un commentaire