Les sanctions économiques sous Trump : entre arme efficace et instrument de puissance aux moyens discutables.
Les sanctions économiques sous Trump : entre arme efficace et instrument de puissance aux moyens discutables.
Depuis le début de son premier mandat, Donald Trump, 45ᵉ président des États-Unis, a privilégié l’usage de sanctions économiques plutôt que le recours direct à la force militaire pour défendre les intérêts américains sur la scène internationale. Cette stratégie s’inscrit dans une évolution des outils de puissance des États-Unis, marquant une préférence pour la coercition économique au détriment de l'intervention armée classique.
Historiquement, la politique étrangère américaine a oscillé entre deux grandes orientations : l’isolationnisme , notamment au XIXᵉ siècle et dans l’entre-deux-guerres , et l’interventionnisme, dominant à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donald Trump, quant à lui, a introduit une nouvelle dynamique, articulée autour du slogan "America First", combinant un retrait relatif du multilatéralisme et un usage intensif de mesures unilatérales coercitives, telles que les sanctions économiques et commerciales.
Depuis son retour triomphal à la Maison-Blanche, à l’issue d’une élection présidentielle remportée haut la main, le président Donald Trump a dressé un constat lucide sur la place des États-Unis dans l’arène internationale, tant sur le plan militaire qu’économique. Il considère que, dans ce qu’il qualifie de "jungle des relations internationales", la puissance économique américaine est menacée par l’émergence ou la montée en puissance de grands blocs économiques, notamment la Chine populaire, l’Inde, le Brésil et l’Union européenne.
Face à un déficit commercial chronique, que Trump juge inacceptable, son administration a opté pour une politique offensive en matière de commerce extérieur. Ainsi, les États-Unis ont imposé des droits de douane particulièrement élevés sur les importations en provenance de plusieurs pays, avec pour objectif déclaré de rééquilibrer la balance commerciale et de relancer l’emploi industriel sur le sol américain , promesse phare de sa campagne électorale.
Des pays comme le Vietnam, la Malaisie ou encore le Mexique ont été particulièrement ciblés par ces mesures, accusés de bénéficier d’accords commerciaux jugés désavantageux pour les intérêts américains. Cette approche protectionniste et unilatérale marque une rupture avec le libre-échange traditionnellement défendu par les administrations précédentes.
Cependant, au-delà de l’usage des sanctions économiques comme principal levier d’influence, l’administration américaine dispose d’autres instruments de puissance, notamment l’extraterritorialité de sa justice. Ce mécanisme, qui permet aux États-Unis d’imposer leurs lois au-delà de leurs frontières, est souvent utilisé pour poursuivre ou sanctionner des acteurs étrangers dont les actions sont perçues comme contraires aux intérêts stratégiques américains.
Un exemple récent illustre cette stratégie : le Brésil, l’un des piliers des BRICS+, adopte sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva une politique étrangère plus indépendante, marquée par un rapprochement avec la Russie, en pleine guerre contre l’Ukraine. Cette orientation géopolitique, jugée inacceptable par Washington, a conduit à une hausse des droits de douane américains sur certains produits brésiliens, mais aussi à des sanctions ciblées.
Parmi celles-ci, des mesures ont été prises à l’encontre d’un juge de la Cour suprême brésilienne, accusé d’avoir agi contre les intérêts de Washington en émettant un mandat d’arrêt contre Jair Bolsonaro, surnommé "le Trump tropical", proche idéologiquement de l’ex-président américain. De plus, des restrictions ont été imposées à la plateforme X (anciennement Twitter), dans le cadre d’un contentieux politique entre les autorités brésiliennes et certains acteurs numériques influencés par l’extrême droite.
Dans le cadre de sa campagne électorale pour l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures, s’il revenait au pouvoir. Toutefois, face à la pérennisation du conflit malgré plusieurs échanges téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine, et la poursuite de l’offensive militaire russe, l'ancien président a adopté un ton plus ferme.
Trump a ainsi menacé d’imposer des droits de douane particulièrement élevés à la Russie, tout en brandissant la possibilité de sanctions économiques secondaires contre les pays qui continuent d’acheter du pétrole russe, notamment la Chine et l’Inde. Il aurait fixé un ultimatum jusqu’au 8 août pour que Moscou parvienne à un accord de paix avec Kyiv, sans quoi des mesures punitives seraient enclenchées.
Cette stratégie place particulièrement l’Inde dans une position délicate. Partenaire commercial majeur des États-Unis, New Delhi tire actuellement profit de l’achat de pétrole russe à bas prix, ce qui renforce sa compétitivité énergétique et alimente sa croissance économique. Face aux pressions américaines, les autorités indiennes ont récemment affirmé qu’elles ne renonceraient pas à leur approvisionnement en pétrole russe, soulignant leur volonté de préserver leur indépendance énergétique et stratégique.
Quant à la Chine, bien qu'elle se trouve également concernée par les menaces américaines, elle dispose d’une position plus solide. Grâce à la taille de son marché intérieur, à son influence sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, et à ses capacités de pression économique, Pékin peut largement contrebalancer d’éventuelles mesures de rétorsion américaines. Dans ce bras de fer géoéconomique, la Chine se montre moins vulnérable que l’Inde, et plus apte à résister aux injonctions de Washington.
La volonté de Donald Trump de tenir ses promesses de campagne se heurte à la réalité complexe de la puissance américaine sur la scène internationale. Bien que les États-Unis disposent d’une supériorité militaire et économique incontestable, leur capacité à imposer un ordre mondial favorable reste limitée par des contraintes budgétaires, une fatigue stratégique et une opinion publique de plus en plus réticente à l’engagement militaire.
Dans ce contexte, l’administration Trump , comme celles qui l’ont précédée , est contrainte de jongler entre l’usage accru des sanctions économiques, perçues comme un moyen de pression moins coûteux et plus flexible, et un refus d’interventions militaires directes, jugées onéreuses et inefficaces à long terme. Ce choix stratégique reflète à la fois une réorientation de la politique étrangère américaine vers un néo-isolationnisme économique, et une reconnaissance des limites de la puissance militaire traditionnelle dans un monde devenu multipolaire et instable.
Auteur : Wilfrid Joseph
Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :
- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html
- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9
- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9
- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation
- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique
- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points
Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

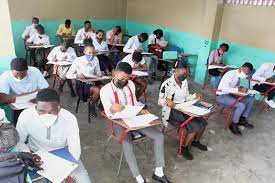
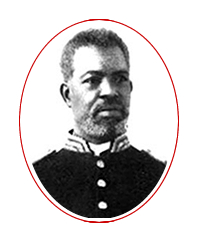


Commentaires
Publier un commentaire