Wendyyy à Santorini — Entre image, polémique et la leçon que Haïti refuse de voir
Wendyyy à Santorini — Entre image, polémique et la leçon que Haïti refuse de voir
Le clip OKAY de Wendyyy déclenche polémique et comparaisons.
Analyse économique et culturelle : Santorini n’est pas forcément cher — quelles
leçons pour Haïti ?
Par Kanndél EDOUARD; économiste et linguiste.
Quand l’écran s’ouvre sur la caldeira de Santorini dans le dernier clip OKAY
de Wendyyy, ce n’est pas seulement un décor : c’est une certitude visuelle qui
tombe dans les timelines. Quelques secondes suffisent pour qu’un grand nombre
de fans haïtiens lisent le plan comme un verdict — Santorini = luxe = “pa pou
nou”. Sur X et Instagram la controverse a pris feu ; on a vu surgir des
comparaisons immédiates entre Wendyyy et Baky, des posts moqueurs et la formule
devenue refrain chez certains supporters : « yo Santo Domingo, nou Santorini ».
Le message est clair : l’image vaut jugement.
Mais qu’est-ce que cette image dit vraiment ? Et qu’est-ce qu’on choisit
d’entendre ? Le clip fonctionne — il capte, il marque, il vend une aspiration
visuelle. Wendyyy sait exactement pour qui il filme : il connaît son public, il
sait comment activer l’émotion, les réseaux et les conversations. Il sait aussi
que, dans la guerre des vues, la mise en scène clinquante rapporte vite. Les
chiffres le prouvent : la sortie du clip OKAY a explosé sur YouTube,
atteignant des centaines de milliers de vues en peu de temps, signe que l’effet
visuel marche et qu’il génère de l’audience instantanée.
1. La musique d’abord — mais pour beaucoup, la
sandale compte plus que le son
Il faut rappeler un fait historique dans l’imaginaire musical haïtien
récent : Santorini est entré pour la première fois dans le vocabulaire
populaire haïtien à travers la chanson “Santorini (Toutouni)” de Gamma Lab.
Ce morceau, festif, insouciant, où l’on évoquait Marbella, Santorini, bikini et
“toutouni”, avait pour seul but de transporter l’auditeur dans une bulle de
vacance, de légèreté et de liberté. Mais au-delà de son refrain accrocheur, il
a surtout introduit Santorini comme synonyme de luxe, d’ailleurs et
d’évasion dans l’imaginaire haïtien. Le lieu a alors été associé à une
expérience inaccessible, presque mythique.
Quand Wendyyy reprend ce décor dans son clip OKAY, il ne fait pas
qu’exploiter un visuel : il convoque tout un bagage symbolique déjà intégré par
son public. Il sait très bien que cette image va déclencher une reconnaissance
immédiate, une sorte de réflexe collectif. Or, cette reconnaissance est biaisée
: elle repose sur l’idée que Santorini est un décor réservé aux riches, aux
“autres”, et certainement pas accessible au citoyen haïtien moyen.
C’est ici que l’on voit l’intelligence stratégique de Wendyyy, mais aussi la fragilité du marché musical local. Dans un écosystème où les KPI dominent — vues, partages, likes, collaborations sponsorisées — une paire de sandales brandées ou un plan à Santorini valent autant qu’un couplet travaillé pour générer l’engagement. Le phénomène n’est pas unique à Wendyyy, mais il est symptomatique : la musique haïtienne, du rap au compas, glisse vers une compétition d’apparence. Résultat : la culture s’appauvrit symboliquement, remplacée par des codes visuels de luxe. Les clashs Wendyyy vs Baky deviennent alors moins des débats de flows ou d’innovations musicales que des guerres d’ego, de décors et de visibilité.
2. « Yo Santo Domingo, nou Santorini » — la
phrase qui dit tout (et rien)
Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à amplifier l’image. Sur X, on a vu
des fans écrire : « Yo Santo Domingo, nou Santorini », une phrase
devenue virale qui illustre bien le raccourci mental. Ce n’est pas une analyse
de clip, ni une discussion sur le propos musical : c’est un slogan de
comparaison sociale. En une ligne, tout est dit. Être à Santorini devient une
manière de dominer ceux qui ne peuvent montrer que Santo Domingo. La musique
disparaît derrière la symbolique du lieu.
Ce qui transparaît dans ce type de commentaire, c’est une blessure
identitaire profonde. Voir un rappeur haïtien tourner dans un décor européen,
même accessible à bas prix, active un mélange d’admiration et d’amertume. Pour
beaucoup, c’est un rappel cruel des conditions matérielles difficiles de la vie
en Haïti, où un voyage en République Dominicaine reste déjà un luxe. Santorini,
dès lors, devient un “ailleurs” inatteignable, utilisé comme instrument de
domination symbolique entre fans.
Mais cette perception repose sur une erreur économique majeure : la
réalité du coût de Santorini est bien différente. Pour un résident européen
— ce qu’est Wendyyy — un billet low-cost et un logement Airbnb suffisent pour
transformer ce rêve supposément inaccessible en escapade banale. L’effet visuel
est donc disproportionné par rapport à la réalité économique. Le public haïtien
projette sur cette image un fantasme plus grand que ce qu’elle représente
réellement.
Autrement dit, « Yo Santo Domingo, nou Santorini » n’explique pas la
démarche artistique, elle ne fait que souligner une fracture sociale et un
imaginaire biaisé. Le risque, c’est qu’à force de confondre mise en scène et
réalité, on continue d’alimenter un malentendu collectif : croire que
l’image dit la vérité, alors qu’elle n’est qu’un outil de stratégie médiatique.
3. Santorini : l’icône n’est pas forcément synonyme de ruine économique pour le visiteur
Dire que Santorini est systématiquement inabordable, c’est ignorer des
réalités concrètes. Oui, il y a des hôtels et des mariages hyper-luxueux; oui,
certains plans de médias concentrent ces images. Mais Santorini offre aussi une
palette de prix et d’expériences : auberges dans les villages intérieurs,
plages publiques, bus locaux à quelques euros, excursions abordables — et des
saisons intermédiaires où les tarifs chutent nettement. Des guides de voyage et
comparateurs montrent que, hors saison haute, il est possible de visiter Santorini
sans se ruiner ; l’hébergement et le transport public proposent des options
économiques. En bref : Santorini n’est pas qu’un mythe doré, c’est aussi un
marché diversifié.
Et pour être clair : un artiste basé en Europe ou qui a la double
nationalité (c’est le cas de certains artistes haïtiens ayant des attaches
européennes) n’a pas besoin d’un énorme budget pour tourner en Grèce. Un billet
low-cost + une location courte, une équipe réduite, quelques jours de tournage
suffisent. Les images que l’on voit comme « hors de portée » peuvent coûter
bien moins qu’on l’imagine. Les posts d’Instagram montrent des déplacements
rapides et ciblés — indice que le coût réel peut être raisonnable pour un
artiste qui se déplace souvent entre l’Europe et la Caraïbe.
4. Ce que Haïti peut apprendre — et pourquoi
copier Santorini aveuglément serait une erreur
Santorini n’a pas été un luxe né du néant ; son attractivité est le
produit d’un temps long : investissements d’infrastructure, diversification des
offres (guesthouses, croisières, événements), et — plus tard — régulations face
à l’overtourism. Elle a ensuite dû encadrer sa croissance pour préserver ses
ressources et sa valeur symbolique. Les décisions récentes de la Grèce
(plafonds pour débarquements de croisières, taxations saisonnières) illustrent
que le succès touristique demande gouvernance et limites.
Haïti peut s’inspirer sans copier : construire sur l’authenticité plutôt
que sur l’ostentation, développer des zones pilotes (Jacmel, Cap-Haïtien),
soutenir la micro-hôtellerie, protéger le patrimoine naturel, et rendre
visibles des réussites concrètes. Plus important encore : il faut modifier la
façon dont on produit images et récits. Au lieu d’importer des décors,
valorisons des vidéos conceptuelles qui parlent de nos lieux, nos fêtes, notre
gastronomie, nos artisans. Ces
récits, bien faits, sont partageables, crédibles et durables.
5. Guerre des vues : révélateur, pas uniquement condamnable
La «
guerre des views » n’est pas un simple concours d’ego, c’est un indicateur des
logiques économiques qui traversent aujourd’hui l’industrie musicale.
L’attention est devenue la monnaie principale : capter des clics, générer du
trafic, puis transformer cette visibilité en opportunités commerciales. Il est
naïf de le nier. Chaque vue peut être monétisée, chaque tendance peut attirer
des sponsors, chaque buzz peut créer des portes. Dans un contexte où les
revenus du streaming sont dérisoires pour les artistes caribéens, la bataille
des chiffres est parfois un moyen de survie.
Mais ce jeu devient dangereux lorsqu’il devient
une fin en soi. Si la quête de vues supplante toute autre logique, le capital
culturel se dilue. Les artistes construisent alors des carrières sur du sable
mouvant : ils gagnent en visibilité immédiate mais perdent en légitimité
durable. L’histoire récente du rap mondial montre que ceux qui traversent le
temps ne sont pas forcément ceux qui alignent les records de vues, mais ceux
qui arrivent à transformer leur notoriété en identité forte, en concepts marquants
et en univers cohérent. Wendyyy, artiste intelligent, stratégique et connecté,
connaît ce dilemme. Il a compris l’efficacité des images et sait parler le
langage de son public. Mais le véritable enjeu, c’est de savoir utiliser ce
même pouvoir visuel pour amplifier des récits haïtiens, pour valoriser un
patrimoine, pour bâtir des ponts entre culture et économie. Une vue n’a de
valeur réelle que si elle laisse une empreinte au-delà de l’écran.
6.
Critique « positivement choquante » : congédier la complaisance visuelle
Il est
temps d’affronter une vérité froide : continuer à valoriser uniquement le
clinquant, c’est vendre notre imaginaire collectif à bas prix. Le public
haïtien — tout comme le public international — mérite plus qu’un décor
standardisé ou des images recyclées. La surenchère de villas, de voitures ou de
paysages exotiques finit par se banaliser. Ce qui reste, ce qui marque, ce qui
voyage réellement, ce sont les histoires et l’authenticité. Les grands succès
mondiaux des dix dernières années, dans différents genres musicaux, ont montré
que les récits culturels singuliers séduisent davantage que la simple
ostentation.
Le vrai choc — et c’est un choc nécessaire — vient
du constat que notre propre industrie musicale troque souvent la profondeur
contre la brillance. L’imaginaire visuel est utilisé comme un feu d’artifice :
éblouissant, mais vite éteint. Or, Wendyyy a les moyens artistiques et
symboliques de briser cette logique. Il peut se permettre d’être critique,
acéré, même provocateur dans sa manière de filmer et de raconter. Un clip peut
être plus qu’un prétexte à montrer des chaussures ou un décor exotique ; il peut
être un manifeste, un miroir social, une provocation constructive. Les
producteurs, managers et labels haïtiens doivent assumer leur rôle de relais.
Ils ne peuvent plus se contenter d’accompagner le goût du public : ils doivent
l’éduquer, le pousser à exiger plus, à désirer des récits qui nourrissent la
durée et non l’instant. Choquer positivement, c’est imposer une vision et créer
une attente nouvelle.
7.
Conclusion — transformer l’émerveillement en chantier
Le
plan de Santorini dans OKAY n’est pas
seulement une belle carte postale : c’est un révélateur. Il révèle à la fois un
biais collectif — celui de croire que tout ce qui brille est hors de portée —
et une opportunité à saisir. L’émotion visuelle que suscite l’image ne doit pas
s’éteindre dans les polémiques superficielles, elle peut servir de point de
départ pour un chantier bien plus vaste. Les fans ont le droit d’être fascinés,
les artistes ont le droit d’être stratèges, mais la société haïtienne ne doit
pas se tromper d’échelle.
Il ne s’agit pas de condamner le déplacement de
Wendyyy, encore moins son ambition. Il s’agit de transformer ce déplacement en
leçon collective : apprendre à valoriser nos propres paysages, nos propres
histoires, nos propres forces. La scène musicale haïtienne dispose d’une
puissance d’influence énorme. Si cette énergie est investie dans la
construction de récits conceptuels, dans la mise en avant de micro-hébergements
locaux, dans la création de circuits touristiques visibles à l’international,
alors la prochaine polémique ne portera plus sur la question « qui a voyagé où
? », mais sur « qui a construit quoi ? ».
Le clip OKAY
doit être lu non comme un fantasme inaccessible, mais comme un miroir.
Santorini peut servir d’inspiration, non parce qu’elle est lointaine et
luxueuse, mais parce qu’elle a su transformer un atout naturel en ressource
économique. Haïti a les paysages, le patrimoine et la culture pour bâtir son
propre récit. La vraie question n’est pas de savoir si un artiste peut voyager
à Santorini, mais si une nation entière peut apprendre à transformer son
émerveillement en stratégie.
Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :
- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html
- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9
- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9
- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation
- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique
- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points
Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

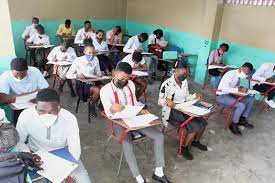
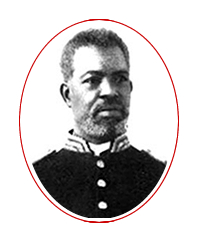


Commentaires
Publier un commentaire