Justice, pouvoir et corruption : les racines d’une crise institutionnelle en Haïti
Justice, pouvoir et corruption : les racines d’une crise institutionnelle en Haïti
« Le pouvoir doit arrêter le pouvoir », affirmait Montesquieu , posant ainsi l’un des principes fondateurs de la science politique moderne. La séparation des pouvoirs est censée garantir aux citoyens une vie paisible et harmonieuse au sein de la société. En Haïti, cependant, la fragilité des institutions et la faiblesse des mécanismes de contrôle favorisent la corruption, qui mine à la fois la légitimité de l’État et la confiance du peuple. Si les élus ont le devoir de mettre en œuvre des politiques publiques bénéfiques sur les plans politique, économique et social, certains en profitent pour commettre des actes de corruption, fragilisant davantage la gouvernance. Parmi les acteurs concernés, la Police nationale d’Haïti (PNH) occupe une place singulière : membre du pouvoir exécutif et auxiliaire de la justice, elle est un corps hybride, au carrefour de la sécurité publique et de l’application de la loi.
La corruption s’entend de tout abus ou de toute utilisation faite à son profit ou pour autrui, de sa fonction ou de son occupation par les personnes visées à l’article 2 de la présente Loi (1) au détriment de l’État, d’un organisme autonome, d’une institution indépendante, d’une collectivité territoriale, d’une organisation non gouvernementale ou d’une fondation bénéficiant d’une subvention publique, d’une entreprise privée avec participation de l’État (2) . Dès lors, comment renforcer la gouvernance dans la lutte contre la corruption en Haïti, en particulier au sein d’institutions clés comme la Police nationale ? Cette étude se propose d’analyser, dans un premier temps, les défis auxquels font face les forces de l’ordre en matière de gouvernance et d’intégrité, avant de présenter, dans un second temps, des pistes de solutions pour améliorer la lutte contre la corruption et renforcer l’État de droit.
Une première forme de corruption, profondément enracinée dans les pratiques locales, concerne le règlement informel des litiges. Historiquement, dans les sections communales, le chef de section exerçait une autorité quasi absolue : il possédait des biens, dirigeait sans contre-pouvoir et tranchait les différends entre habitants, sa parole faisant office de loi. Cette culture persiste aujourd’hui, sous une forme modernisée , certains citoyens sollicitent directement des policiers pour arbitrer des conflits de voisinage, contournant ainsi les juges de paix. Dans un quartier, par exemple, après une altercation consécutive à un match de football, un père peut se tourner vers un policier ami pour “rendre justice” contre une somme d’argent. Ces pratiques, qui transforment les agents de police en juges informels rémunérés, normalisent la corruption et brouillent la séparation des fonctions judiciaires et policières.
Une deuxième forme de corruption touche directement la mission fondamentale de la Police nationale d’Haïti : la protection de la population. Dans un contexte d’insécurité généralisée, les citoyens, déjà contraints de cohabiter avec des groupes armés, se voient parfois obligés de payer à la fois les gangs et certains policiers pour circuler en sécurité. Des témoignages rapportés par la presse font état de rançonnements systématiques des chauffeurs de transport en commun par des agents chargés de sécuriser les axes routiers. L’un d’eux rapporte qu’après avoir refusé un paiement, un policier lui aurait répliqué : « Vous acceptez de payer les gangs, il faut aussi nous payer, car c’est nous qui protégeons l’axehttps://ayibopost.com/des-policiers-haitiens-extorquent-des-chauffeurs-aux-postes-de-controle/ . » Ce type de pratique, en plus de compromettre la confiance du public, installe la peur, détourne la fonction de protection au profit d’intérêts personnels et révèle des failles graves dans la gouvernance sécuritaire et le contrôle interne de l’institution.
Enfin, un autre domaine particulièrement affecté est celui de la circulation routière et des services administratifs liés aux véhicules. Le Code de la route prévoit des sanctions pécuniaires en cas d’infraction, afin à la fois de corriger les comportements dangereux et de contribuer aux recettes publiques. Or, en pratique, certains policiers détournent ce mécanisme en acceptant ,voire en sollicitant ,des paiements directs, souvent inférieurs aux amendes légales, en échange de l’annulation de la contravention. Les chauffeurs eux-mêmes participent à ce système en privilégiant cette solution informelle pour éviter la lenteur et la complexité des démarches administratives. Cette logique de contournement, parfois étendue à la régularisation accélérée de documents de véhicule moyennant paiement à un policier, illustre un cercle vicieux où la corruption est perçue comme un “gain de temps” et où l’État perd à la fois son autorité et ses ressources.
Somme toute, la corruption demeure l’un des principaux obstacles au développement économique, social et institutionnel d’Haïti. Elle mine la confiance du peuple envers ses dirigeants, affaiblit l’autorité de l’État et retarde la mise en œuvre des politiques publiques au service du bien commun. Elle ne se limite pas à des comportements déviants isolés, elle est profondément enracinée dans des pratiques sociales, des réflexes institutionnels et une culture d’impunité qui fragilisent la gouvernance dans son ensemble.
La combattre exige une approche globale. Il est essentiel non seulement de sanctionner les auteurs avec rigueur, mais aussi de comprendre les causes profondes qui l’alimentent : lenteur et complexité du système judiciaire, confusion des rôles entre les différentes institutions, faiblesse des mécanismes de contrôle interne, pressions politiques, mais aussi attentes et comportements de la population qui, faute de confiance en la justice, se tourne vers des solutions parallèles. Dans le cas de la Police nationale d’Haïti, ces dysfonctionnements se traduisent par une perte d’autorité morale, des pratiques illégales institutionnalisées et une relation distendue avec la population qu’elle est censée protéger.
Dès lors, des réformes profondes s’imposent. Clarifier les rôles de chaque acteur institutionnel, rendre la justice plus accessible, rapide et crédible, renforcer les organes de contrôle et de discipline interne de la police, instaurer une véritable culture de reddition de comptes et d’intégrité, mais aussi investir dans la formation et le bien-être des agents sont des conditions essentielles pour rompre le cycle de la corruption. Cette lutte ne doit pas être perçue comme un combat isolé, mais comme le socle même d’une gouvernance renouvelée, capable de restaurer la confiance citoyenne et de faire reculer l’impunité. In extenso, il faut inscrire cette démarche dans une vision d’avenir : celle d’un État de droit solide, d’institutions modernes et respectées, et d’une société qui ne tolère plus le troc de l’autorité publique contre des intérêts privés. L’expérience d’autres pays montre qu’aucune réforme n’est impossible lorsque la volonté politique, la pression citoyenne et le soutien international convergent vers un même objectif : libérer l’État de la capture par la corruption et le remettre au service exclusif de la nation. C’est à ce prix seulement qu’Haïti pourra sortir du cercle vicieux de la faiblesse institutionnelle pour entrer dans celui de la stabilité, de la justice et du progrès durable.
(1) La présente Loi s’applique à tout individu, toute personne morale, toute organisation non gouvernementale (ONG), ou toute entreprise du secteur privé tant national qu’étranger, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d’une organisation internationale, ayant participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d’un acte de corruption. Elle couvre le fait, par quiconque, de faire directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à l’une des personnes mentionnées à l’alinéa 1 du présent article et, de manière générale, à toute personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, en échange de sa collaboration indue dans le cadre de sa fonction, mission ou mandat. Elle s’étend aussi au fait, par quiconque, de solliciter, d’accepter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, par lui-même ou pour autrui, afin d’user de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir ou de faire obtenir d’une personne, d’un service, d’un organe, ou d’une institution de l’Administration publique nationale des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre mesure favorable.
(2) Loi du 9 mai 2014 portant prévention et répression de la corruption.
Eduardo MASSENA
Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :
- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html
- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9
- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9
- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation
- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique
- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points
Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

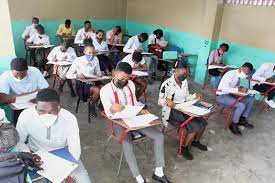
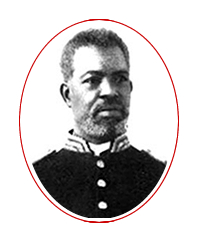


Commentaires
Publier un commentaire