Droits de l’enfant et justice pénale en Haïti : évaluation des normes nationales à la lumière des standards internationaux
Droits de l’enfant et justice pénale en Haïti : évaluation des normes nationales à la lumière des standards internationaux
L’enfant demeure un être sensible que nous
devons impérativement protéger, car il représente non seulement l’avenir de
toute société, mais aussi la transmission de nos valeurs, de nos mœurs et de
notre culture. Il est donc essentiel de mettre en place un ensemble de
mécanismes ayant pour mission d’encadrer l’enfant, de le protéger des dangers
du monde extérieur et, en cas de délinquance, de favoriser sa réinsertion
sociale. Dans cette perspective, de nombreuses avancées ont été réalisées tant
au niveau national qu’international pour garantir la protection des droits de
l’enfant. Ainsi, les législations internes tendent de plus en plus à s’aligner
sur les normes internationales adoptées par les États afin de renforcer la
protection juridique de l’enfant.
En Haïti, la loi du 7 septembre 1961,
adoptée sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, constitue un cadre de
référence pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Par
ailleurs, la Convention
relative aux droits de l’enfant, ratifiée par Haïti le 23 septembre 1994,
impose aux États parties l’obligation d’adapter leurs législations nationales
aux principes et dispositions de ladite convention.
Dans ce contexte, ce travail vise à analyser l’adéquation entre la loi du 7 septembre 1961 et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment à travers les articles 12, 37 et 40. Il s’agira d’identifier les points de convergence et de divergence entre ces deux textes juridiques et, le cas échéant, de proposer des recommandations pertinentes pour améliorer la protection et le bien-être des enfants en Haïti.
2-
La
convention internationale relative aux droits de l’enfant
La Convention internationale
relative aux droits de l’enfant (CIDE) a été adoptée le 20 novembre 1989 par
l’Assemblée générale des Nations Unies et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Cette convention s’inscrit dans la
continuité de la Déclaration universelle des droits de l’homme[1],
qui place l’être humain, y compris l’enfant, au centre des préoccupations de la
communauté internationale. D’ailleurs, cette Déclaration reconnaît
explicitement que les enfants ont droit à une aide et à une assistance
spéciale, en particulier en cas de vulnérabilité.
La CIDE affine ce principe en développant un ensemble de droits spécifiques
destinés à garantir la protection, le développement et la participation de
l’enfant dans la société. Elle affirme que l’enfant doit être élevé dans un
esprit de paix,
de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité. Elle interdit toute forme de
discrimination à l’égard des enfants, quelle que soit leur race, couleur, sexe,
origine ethnique ou sociale, situation économique, opinion ou religion.
Par ailleurs, la Convention établit clairement que tout être humain âgé de moins de 18 ans
est considéré comme un enfant, sauf si la majorité est atteinte plus tôt selon
la législation nationale. Elle reconnaît aussi, comme droit fondamental, le droit à la vie
de chaque enfant, ainsi que son droit à survivre, se développer, être protégé
contre les abus et participer activement à la vie sociale et civique.
3-
Loi
du 7 septembre 1961
La loi
du 7 septembre 1961 considère le mineur comme un être à part,
que la loi doit protéger en raison de sa vulnérabilité, mais aussi accompagner
en cas de déviance ou de délinquance juvénile. Elle prévoit l’adoption de
mesures appropriées afin de favoriser le développement harmonieux de l’enfant,
tout en apportant une réponse adaptée en cas d’infraction grave. En ce sens,
cette loi encadre la responsabilité pénale du
mineur, dans une logique à la fois protectrice et éducative. Elle vise à assurer la protection de
l’enfant tout en établissant les conditions d’intervention de la justice
lorsqu’un mineur commet une infraction. L’objectif est double : corriger les comportements déviants et
préparer
l’enfant à devenir un adulte responsable, au service de la
société.
La loi du 7 septembre 1961 prévoit ainsi des mesures éducatives et
répressives, en tenant compte de l’âge et
de la
situation personnelle de l’enfant. Toutefois, malgré son
importance dans l’évolution du droit des mineurs en Haïti, cette loi présente
une lacune majeure : elle ne fixe pas clairement un âge minimum de responsabilité pénale,
ce qui peut entraîner des interprétations variables et des traitements inégaux
selon les cas. Malgré cette limite, la loi du 7 septembre 1961 a représenté une
étape
significative vers la reconnaissance des droits de l’enfant en
Haïti, en posant les bases d’un encadrement juridique destiné à garantir la protection, l’éducation
et la réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi.
4-
Point
convergents
A) L’aspect éducatif
L’enfant
demeure un être sensible, sans expérience, qui s’appuie sur la société pour se
construire et devenir un citoyen utile. La loi du 7 septembre 1961 et la Convention relative aux droits de l’enfant reconnaissent toutes
deux l’importance de l’approche éducative dans la prise en charge des mineurs
en conflit avec la loi. Plutôt que de privilégier une réponse strictement
punitive, ces deux textes juridiques insistent sur l’éducation et la réinsertion comme éléments centraux du
traitement des enfants délinquants.
Le mineur, encore en construction
intellectuelle et morale, ne perçoit pas clairement la différence entre le bien
et le mal comme le ferait un adulte. C’est pourquoi il est essentiel de le guider et de lui inculquer des
repères, plutôt que de le condamner hâtivement. En effet, une incarcération précoce peut
accroître les risques de récidive, en exposant l’enfant à des modèles négatifs
en milieu carcéral. En ce sens, l’approche
éducative apparaît comme la plus viable, et ces deux textes convergent vers
cette logique protectrice et constructive.
B)
L’existence
de juridictions spécialisées
L’enfant requiert une attention particulière et individualisée,
notamment en matière de justice. Reconnaissant que le mineur n’a pas la même
capacité d’appréciation des actes que l’adulte, la loi du 7 septembre 1961 et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
recommandent toutes deux la création de
juridictions spécialisées pour mineurs.
Ces juridictions doivent être composées
de professionnels formés à la
psychologie et au développement de l’enfant, afin d’assurer un traitement
adapté à leur âge, à leur maturité et à leur situation. L’objectif est de
garantir un jugement équitable,
respectueux des droits de l’enfant, et de favoriser des décisions centrées sur l’intérêt supérieur du mineur. Ce
point de convergence démontre une volonté commune de traiter la délinquance
juvénile dans un cadre spécifique, humanisé et respectueux.
C)
L’incarcération
comme ultime recours
Les deux textes s’accordent sur le fait
que la privation de liberté ne
doit être envisagée qu’en dernier
recours et pour une durée aussi
courte que possible. L’emprisonnement d’un enfant ne doit jamais être
automatique ni systématique. Au contraire, la loi du 7 septembre 1961 comme la
Convention privilégient des
alternatives à l’incarcération, telles que l’insertion dans des centres de rééducation,
l’accompagnement éducatif ou la médiation. Ces mesures visent à corriger les comportements déviants
tout en préservant l’avenir de l’enfant. En effet, le mineur est perçu
comme un être en devenir, porteur d’un potentiel que la société a le devoir
d’encadrer, et non de détruire. Le recours à des sanctions éducatives plutôt
que punitives est un marqueur fort de la convergence entre ces deux instruments
juridiques.
5-
Les
points divergents
D)
Le droit
d’être entendu
L’article 12 de la Convention relative
aux droits de l’enfant reconnaît expressément à l’enfant le droit de s’exprimer librement sur toute question
l’intéressant, notamment dans le cadre de procédures judiciaires ou
administratives le concernant. Ce droit peut s’exercer directement par l’enfant
ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une institution appropriée. En
revanche, la loi haïtienne du 7
septembre 1961 ne consacre pas explicitement ce droit. L’audition du
mineur y est souvent informelle, et il n’est pas systématiquement consulté,
même lorsque la procédure concerne sa propre situation. Cette divergence
traduit une approche paternaliste
dans la loi nationale, où la parole de l’enfant est souvent reléguée au second
plan au profit de celle de ses représentants légaux. La Convention, quant à
elle, reconnaît l’enfant comme un sujet
de droit à part entière, capable d’exprimer ses ressentis et de
contribuer à la compréhension de ses actes, notamment en cas de délinquance.
E) 2. La détention dans un milieu carcéral
séparé
L’article 37 de la Convention stipule
que les mineurs privés de liberté
doivent être séparés des adultes, sauf s’il est dans l’intérêt supérieur
de l’enfant de ne pas l’être. De plus, la Convention insiste sur le droit de
l’enfant à un traitement respectueux de sa dignité, ainsi que sur la nécessité
d’informer rapidement ses parents ou représentants légaux. Or, la loi du 7 septembre 1961 ne prévoit pas
expressément cette séparation carcérale, et dans la pratique haïtienne actuelle, cette disposition de la
Convention est régulièrement violée. Selon une enquête d’Ayibopost, plus de 300 détenus mineurs cohabitent avec
des adultes au sein du CERMICOL[2],
ce qui constitue une grave atteinte aux normes internationales de protection de
l’enfance. Ce manque d’infrastructures
spécialisées contribue à la dégradation des droits fondamentaux des
mineurs détenus.
F) 3. Le droit à une assistance juridique
La Convention, notamment dans ses
articles 37 et 40, prévoit que tout enfant accusé d’une infraction a le droit
d’être assisté par un avocat ou par une
personne qualifiée à toutes les étapes de la procédure. Cela vise à
garantir un procès équitable et à protéger le mineur contre tout traitement
arbitraire. La loi du 7 septembre 1961, quant à elle, ne fait pas mention explicite du droit à une assistance juridique,
et dans la pratique haïtienne, ce droit
est très peu respecté. Il est rapporté qu’environ 95 %[3] des
mineurs incarcérés au CERMICOL sont en détention préventive prolongée,
sans avoir été jugés, ni assistés par un avocat. Cette situation constitue une violation manifeste des droits de la défense
et montre les limites de la législation nationale à garantir les garanties
procédurales fondamentales.
G)
4. La
présomption d’innocence
L’article 40 de la Convention insiste
sur le fait que tout enfant accusé
d’une infraction doit être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.
Il doit également être informé rapidement des charges qui pèsent contre lui,
dans une langue qu’il comprend, et avoir la possibilité de se défendre sans
contrainte. La loi haïtienne du 7 septembre 1961 ne prévoit pas formellement la présomption d’innocence dans le
traitement des mineurs délinquants. Dans la pratique, les enfants sont souvent détenus sans jugement, et subissent les procédures dans les mêmes
conditions que les adultes, ce qui est contraire aux normes
internationales. Il en résulte une grande
vulnérabilité juridique des mineurs, abandonnés dans un système
judiciaire qui ne leur garantit pas les droits procéduraux fondamentaux.
Recommandations
H) Reconnaître le droit de l’enfant à être
entendu
L’enfant doit
pouvoir exprimer librement son opinion dans toute procédure le concernant,
qu’elle soit administrative ou judiciaire. Il est essentiel de comprendre les raisons de ses actes
afin de pouvoir y répondre de manière adaptée et éducative. Ce droit, consacré
par l’article 12 de la Convention, doit être formellement intégré dans la
législation nationale, et les juges doivent être formés à l’écoute active et
respectueuse des enfants.
I) Assurer une assistance juridique
obligatoire et gratuite pour les enfants en conflit avec la loi
Il est
inadmissible que près de 95 % des
enfants en détention ne soient ni jugés ni assistés par un avocat. Cette
situation constitue une grave violation des droits fondamentaux. Il est donc
urgent de garantir à tout enfant suspecté d’une infraction le droit à une
assistance juridique compétente dès le début de la procédure. Un enfant privé
de sa liberté, sans procès équitable, risque de subir des séquelles psychologiques et sociales
irréversibles.
J) Mettre en place des garanties
procédurales solides
L’enfant doit
bénéficier d’un procès équitable,
sans discrimination ni parti pris. Il doit avoir accès à une défense complète,
être informé de ses droits, et être présumé innocent jusqu’à preuve du
contraire. L'absence de telles garanties pourrait entraîner des erreurs judiciaires, avec des
conséquences lourdes sur le développement psychologique et social du mineur.
Une telle injustice alimente la méfiance envers les institutions et peut
conduire à la récidive.
K) Créer et adapter des centres de
détention spécifiques pour mineurs
Il est
impératif de séparer les enfants des
adultes en détention, conformément aux exigences de la Convention. La
cohabitation avec des détenus adultes expose les mineurs à des violences
physiques, psychologiques et parfois sexuelles, ce qui compromet gravement leur
sécurité et leur développement. Il convient d’aménager des centres spécialisés axés sur l’éducation et
la réinsertion, où les enfants reçoivent un accompagnement
individualisé.
L) Définir un âge minimum de
responsabilité pénale
L’absence d’un âge minimum de responsabilité pénale constitue un flou juridique préjudiciable. Il est fondamental de fixer un âge clair, en tenant compte des critères psychologiques, sociaux et culturels propres à l’enfance. Cela permettra non seulement de mieux protéger les enfants, mais aussi de garantir une réponse pénale appropriée à leur maturité et à leur capacité de discernement.
Auteur : EDUARDO MASSENA
Source
1)
Convention
relative aux droits de l’enfant (1989)
2)
Loi
du 7 septembre 1961
3)
Déclaration
universelle des droits de l’homme
4)
https://www.collectif-haiti.fr/rnddh-/
5)
https://www.collectif-haiti.fr/rnddh-/
[1] Adoptée par les 58 Etats membres de
l’ONU le 10 décembre 1948.
[2] Centre d'Éducation et de Réinsertion sociale des Mineurs
en Conflit avec la Loi
[3] https://www.collectif-haiti.fr/rnddh-/
Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :
- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html
- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9
- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9
- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation
- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique
- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points
Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

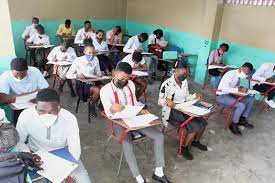
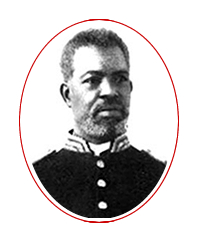


Commentaires
Publier un commentaire